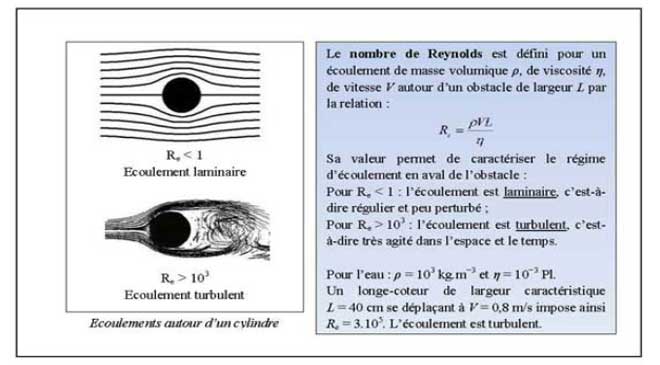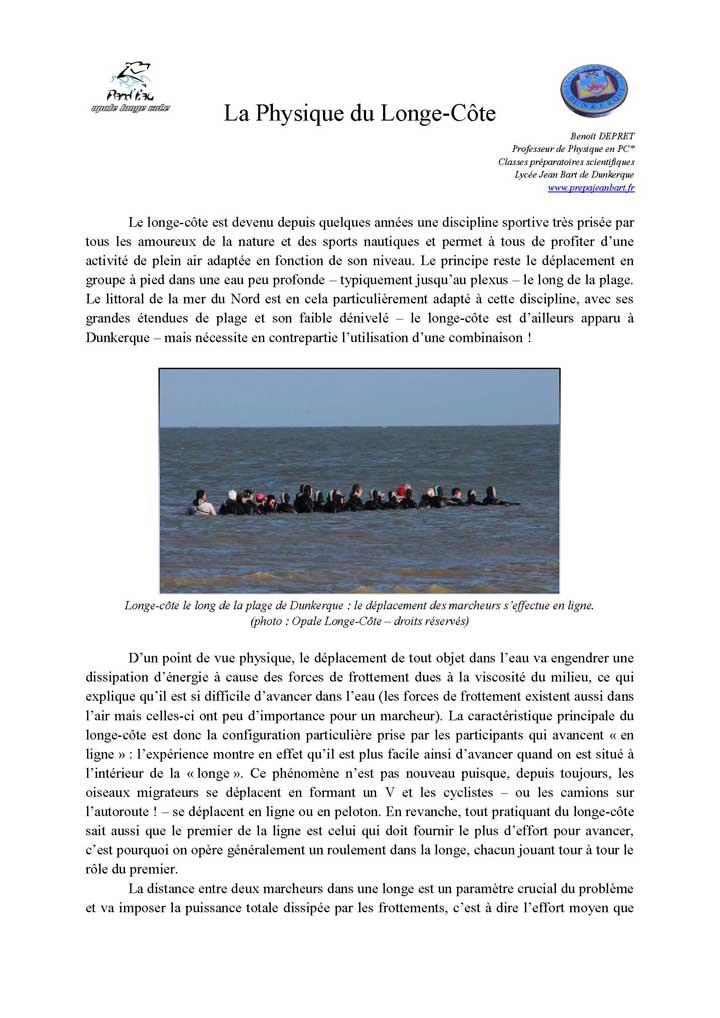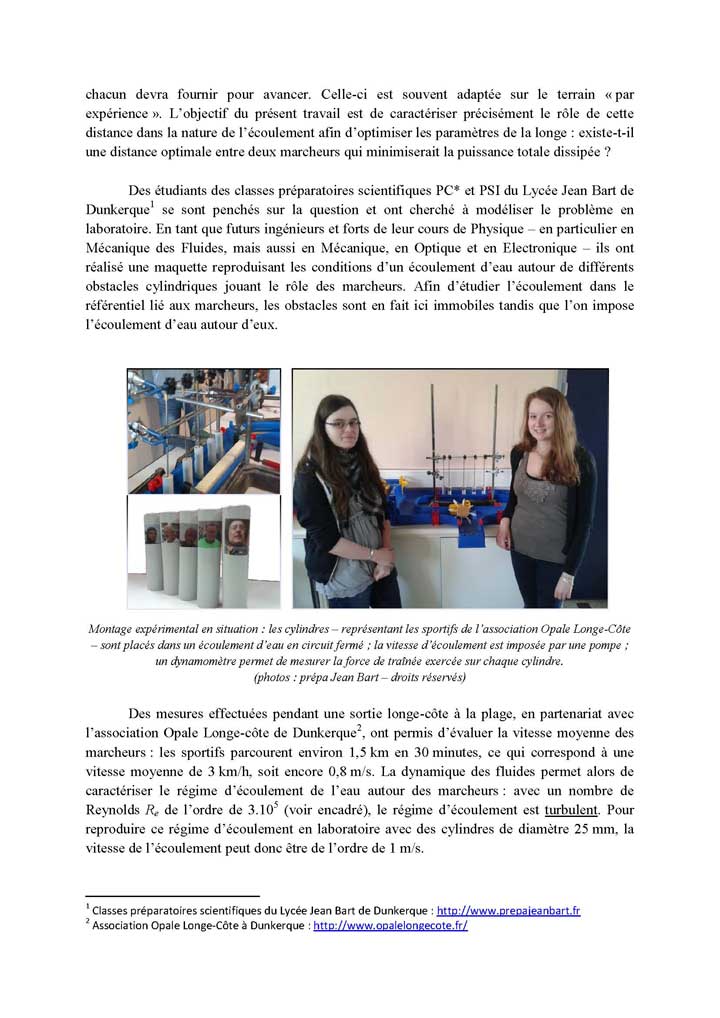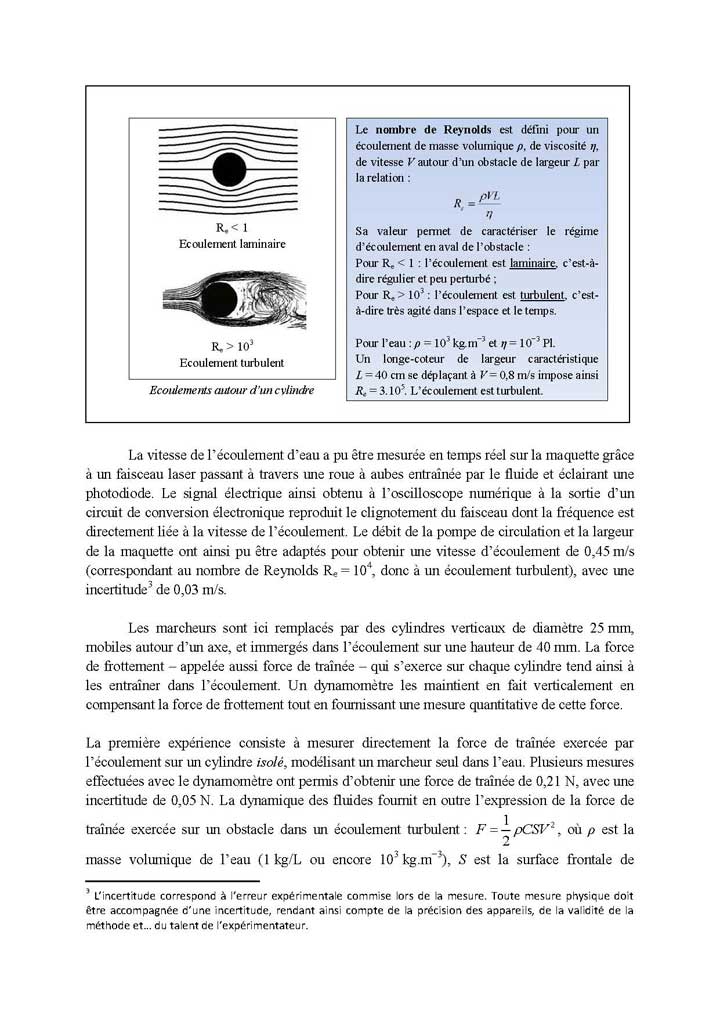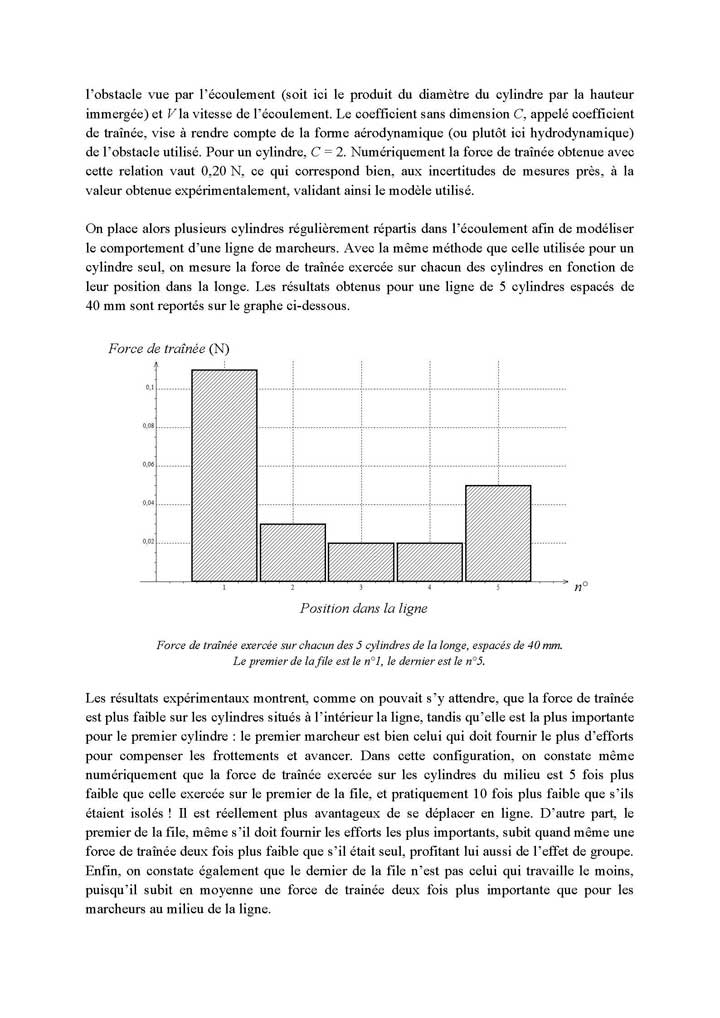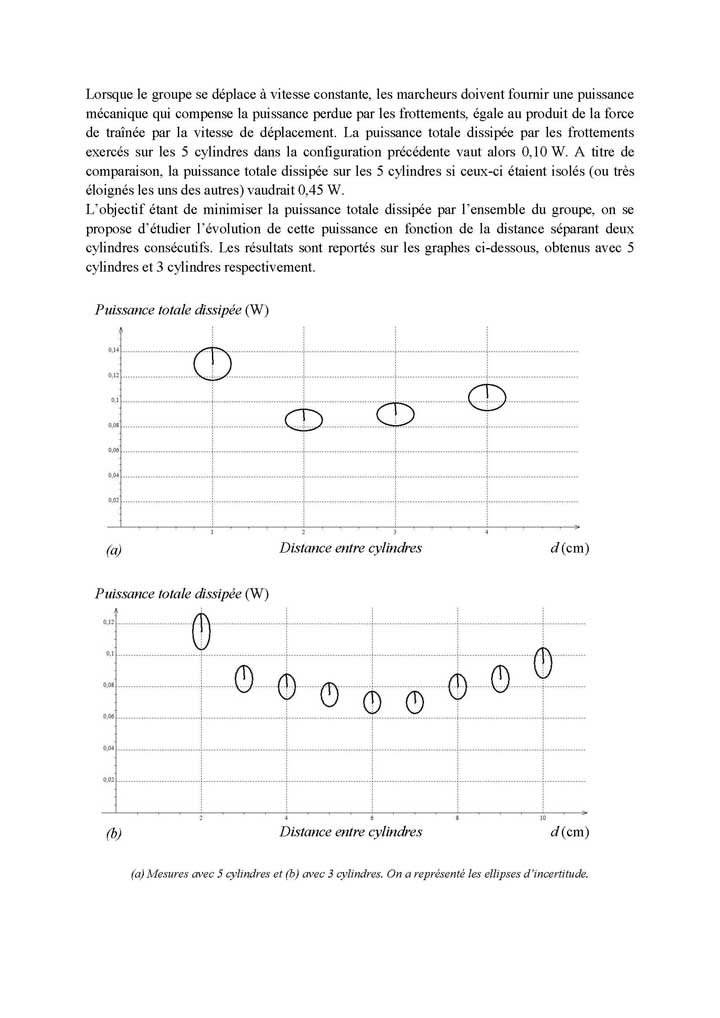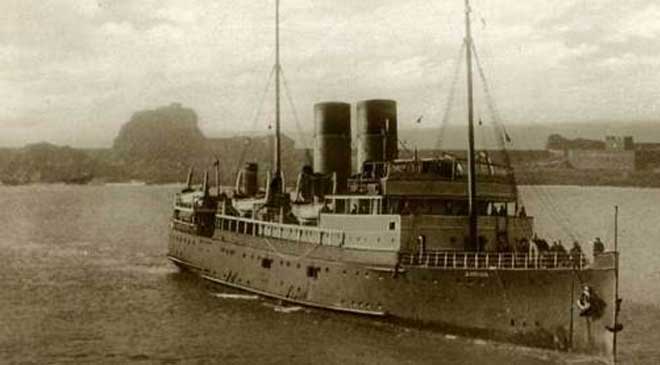D’un aspect blanchâtre et granuleux dans nos salières, il est invisible dans la longe. Pourtant il est bien présent se révélant discrètement par évaporation, et amèrement à la première « tasse »
Pourquoi la mer est-elle salée, alors que les lacs et les rivières ne le sont pas ? D’où vient ce sel ? La mer devient-elle de plus en plus salée ou au contraire ? Nous vous proposons un dossier autour de ce sel marin dans lequel nous marinons tout au long de la longe.
C’est quoi du sel ?
Dans la nature, il n’existe pas un sel, mais plusieurs sels, C’est une association de particules chimiques qu’on appelle des ions (chlorure, sulfates… ). Dans la vie courante, le sel que nous côtoyons le plus régulièrement est le sel de table ou Chlorure de Sodium (Na Cl). C’est le même sel que nous goutons involontairement pendant certaines longes.
Dans l’eau de mer il représente 77% des différents sels présents et domine par son gout prononcé et sa légère amertume. S’il relève notre cuisine, il relève aussi nos longes. Que serait une longe en eau douce ?
D’où vient ce sel?
Il nous faut revenir presqu’à l’origine de la Terre, soit environ 3,7 milliards années. A cette époque la seule longe possible est à pratiquer dans les fleuves de laves qui s’échappent des entrailles de la Terre. Pas une mer, ni un lac ni une goutte d’eau ! L’eau n’existe que sous forme de vapeur qui s’échappe des volcans. En même temps s’échappent aussi de nombreux gaz dont le chlore.
100 millions d’années plus tard, la terre se refroidit permettant la condensation des vapeurs d’eau qui se sont accumulées dans l’atmosphère. Les premières pluies, de cette planète, démarrent. Pour bien comprendre l’ampleur de ces précipitations, toute l’eau des océans, des fleuves, des glaciers que nous avons aujourd’hui en surface et dans les profondeurs se trouvait à l’époque dans l’atmosphère. Contrairement à ce que craignaient les gaulois, ce n’est pas le ciel qui nous est tombé sur la tête, mais les océans !
Les gouttes d’eau de ces pluies diluviennes se sont associées aux gaz fortement présents dans l’atmosphère et notamment le chlore. Nous avons eu nos premières pluies acides, très acides!
Ces pluies acides ont lessivés les roches riches en sels minéraux, dont le sodium, avec lesquelles elles entraient au contact. C’est l’origine du chlorure (Cl) de sodium, (Na) notre sel de table
Le ruissellement de ces pluies, se chargeant en sels minéraux, vers les points les plus bas ont été à l’origine de la formation des mers et des océans.
Pourquoi la mer est-elle salée ?
Quand on lit l’étiquette d’une bouteille d’eau minérale, il y est mentionné plusieurs composés dont des sels minéraux. Il y a aussi des sels minéraux dans l’eau de mer, pourtant l’une est douce et l’autre salée. Cette différence s’explique simplement par les concentrations plus fortes en sels minéraux dans l’eau de mer.
Chacun sait que la surface des océans s’évapore régulièrement sous l’action du vent et de la chaleur. Seule l’eau s’évapore, pas les sels minéraux qui restent piégés dans la mer.
D’un côté nous avons un apport régulier en sels minéraux dans la mer, par le ruissellement des eaux de surface et en eaux souterraines. De l’autre côté nous avons une évaporation permanente de l’eau. Mécaniquement la concentration en sels augmente. L’eau agit comme un taxi dont les clients sont les sels minéraux.
La mer devient elle plus salée ?
Comme les minéraux arrivent en permanence dans la mer, elle devrait devenir de plus en plus salée.
Par exemple, la mer morte devient de plus en plus salée. C’est un ancien océan qui s’est retrouvé isolé. L’évaporation forte dans une région chaude du globe et un apport d’eau douce très faible sont la cause de cette hyper-salinité. En une trentaine d’années le niveau de la mer morte a baissé de plus de 20 mètres.
Pourtant la salinité des autres océans ne varie presque plus avec des apports (rivières) et des retraits qui s’équilibrent. La plupart des mers & océans sont connectés ce qui limitent les déséquilibres en sel. La salinité moyenne de la mer est de 30gr sel / kg d’eau
J’ai déjà évoqué des apports en sels avec les eaux de ruissellements, mais pour les retraits de quoi parle-t-on ? Il ne s’agit pas de nos prélèvements marginaux de sel, des marais salants, pour assaisonner nos plats. Alors où part le sel qui devrait s’accumuler dans la mer et la transformer en salière géante.
La réponse est qu’une partie du sel, du moins son sodium se fixe dans certaines roches de types argileux, basaltiques… Cette opération se fait dans des endroits particuliers, principalement sur les lignes de séparation des plaques continentales en des zones très chaudes, le basalte est une roche volcanique.
Les chlorures eux, restent tranquillement dans l’eau attendant un nouvel apport de sodium. Il est estimé par des scientifiques que l’eau de la mer se renouvelle tous les 40 000 ans. Les éléments du sel ont un cycle de plus de 60 millions d’années (eau-roche-eau)
Pensez-y la prochaine fois que vous faites pipi dans l’eau, 40 000 ans pour l’eau et 60 000 000 d’années pour le sel, ce n’est pas rien ! BTh
Salinité moyenne
Dans un litre d’eau de mer les 35g de sels sont composés de:
– 27,21g de chlorure de sodium
– 3,81g de chlorure de magnésium
– 1,66g de sulfate de magnésium
– 1,26g de sulfate de calcium
– 0,86g de sulfate de potassium
– 0,12g de carbonate de calcium
– 0,07g de bromure de magnésium
– 0,01g d’autres sels
 Observée, photographiée prisonnière du maillot de nos accompagnateurs faisant office de filet à plancton.
Observée, photographiée prisonnière du maillot de nos accompagnateurs faisant office de filet à plancton.